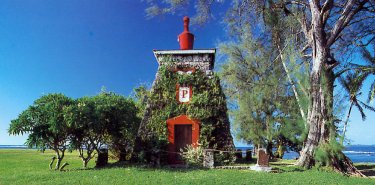LE POLYNESIEN ET SON HISTOIRE
![]()
L'histoire de Tahiti puise ses sources aux temps les plus lointains mais l'origine de ses habitants qui abordèrent l’île au terme d'étonnantes migrations à travers le grand Océan reste incertaine et les hypothèses contradictoires. Les Polynésiens venaient-ils de l'est ou de l'ouest ? Les démonstrations sportives de Thor Eyerdal ou d'Eric de Bishop n'ont pas fourni d'élément probant. Une origine caucasienne avec cheminement par le sud-est asiatique et les Hébrides a été évoquée mais une hypothèse plus récente fondée sur des découvertes archéologiques, anthropologiques et linguistiques a pour elle I'avantage de la simplicité et de la logique. Elle fait remonter les Polynésiens à des ancêtres vivant il y a plus de 6 000 ans sur la côte chinoise au sud du Yang-Tse. A la suite de migrations successives passant par Taiwan, les Philippines et la Micronésie, ils atteignirent les Marquises vers I'an 300. De là, ils colonisèrent la Polynésie Centrale et Hawaï dans les cinq siècles qui suivirent et sans doute vers I'an 400 I'île de Paques puis vers I'an 900, la Nouvelle-Zélande.
A I'arrivée des premiers visiteurs européens, la civilisation polynésienne était dominée par des chefferies puissantes s'appuyant sur des structures sociales très marquées, et soumises à des règles religieuses et héréditaires très strictes. La société comprenait les rois, les princes, les chefs, les nobles et les bourgeois, puis le peuple, et enfin les esclaves, les prisonniers et les serviteurs. Il y avait aussi des prêtres qui célébraient les cérémonies du culte rendu au grand dieu ORO, cérémonies qui s'accompagnaient parfois de sacrifices humains sur les " marae " sortes de temples en plein air.
Si I'archipel des Marquises fut le premier à être découvert en 1595 par I'Espagnol MEN DANA, et si des navigateurs hollandais traversèrent les Tuamotu en 1616, puis en 1722, il a fallu attendre I'année 1767 pour qu'au mois de juin, le navigateur anglais WALLIS soit le premier A arriver à Tahiti A bord du " DOLPHIN ". L'année suivante ce fut au tour du Français BOUGAINVILLé, parti de BREST avec " LA BOUDEUSE " et " L'ETOILE ". Puis COOK qui était venu une première fois comme officier à bord du " DOLPHIN ", revint plusieurs fois A partir de 1769. Durant leurs séjours, ces visiteurs, malgré quelques incidents, avaient entretenu des relations amicales avec la population. Une tentative de colonisation espagnole eut lieu en 1772, mais elle fut totalement abandonnée en 1775, A la suite du décès à Tautira de DON DOMINGO BOENECHEA, envoyé du vice-roi du Pérou.
Cependant malgré l'heureux caractère de ses habitants, la Polynésie n'était pas sans connaître les troubles des luttes intestines. Tous les rois de Tahiti et des îles se faisaient périodiquement la guerre, et la suprématie de la dynastie POMARE ne commença véritablement à se dessiner que vers 1773. Son pouvoir s'exerça d'abord aux îles du Vent pour s'étendre peu à peu à I'archipel de la Société et aux Tuamotu, aidé en cela d'ailleurs par les Anglais qui possédaient la poudre et les canons.
C'est en 1789 que se situe le célèbre épisode des mutins du " BOUNTY ", qui devaient finalement se retirer à l’île déserte de Pitcairn, devenue ensuite anglaise.
Les missionnaires protestants anglais entreprirent les premiers la christianisation de Tahiti où ils arrivèrent en 1797, et prirent peu à peu une part importante aux affaires du pays. Aussi, à I'arrivée des prêtres français catholiques en 1836, le pasteur protestant Georges PRITCHARD, installé depuis 1824 à Tahiti où il avait pris chaque jour plus d'influence, s’opposa-t-il vivement à leur débarquement et obtint de la reine POMARE IV leur expulsion ainsi que celle d'autres Français installés dans le pays. Le Gouvernement français considéra cette attitude comme une atteinte aux droits des gens et une intervention fut jugée nécessaire. La lutte s'engagea alors entre protestants et catholiques, et derrière eux, entre I'Angleterre et la France. Cette lutte dura jusqu'en 1842, date à laquelle un groupe de grands chefs qui nous étaient favorables formulèrent une demande de protectorat auprès de la France, seule mesure susceptible de rétablir I'ordre dans le pays. Cette demande fut approuvée par la reine POMARE IV, et le protectorat ratifié par Louis-Philippe en 1843.
Mais le calme n'en était pas revenu pour autant à Tahiti et les querelles, tant religieuses que politiques, reprirent de plus belles jusqu'en 1880, date à laquelle le jeune roi POMARE V, de santé fragile et sans enfant pour lui succéder, signa, devant I'assemblée des grands chefs, l'acte de remise à la France des îles de la Société, en conservant toutefois son titre et son pavillon. Le 12 juin 1891, le roi POMARE V s'éteignait et le pavillon français flotta désormais sur le palais royal de Papeete. La prise de possession des îles sous le Vent n'eut lieu qu'en 1888. Les comptoirs français dans le Pacifique, réunis sous le nom d'Etablissements français de l'Océanie (aujourd'hui Polynésie Française) comprenaient alors, en dehors de Tahiti et de I'archipel de la Société, les îles Marquises (annexées en 1842 par le vice-amiral DUPETIT-THOUARS) et les Gambier (protectorat en 1844, annexion en 188 1, ratifiée en 1882), auxquelles vinrent s'ajouter les îles Australes en 1900, puis l'îlot Clipperton.
Durant la Grande Guerre, Papeete est bombardé par deux croiseurs allemands. Puis, lors de la Seconde Guerre Mondiale, le "Bataillon du Pacifique" rejoint la France Libre pour combattre en Afrique du Nord, puis en Europe. Les Américains créent aussi une base en 1943 à Bora-Bora. La création des sites pour les essais nucléaires à Fangataufa et Moruroa commencent en 1956 et reprennent en 1995 pour d'ultimes tests réels. En ce qui concerne le statut politique, un traité d'autonomie a abouti en 1984 avec l'appelation de Territoire d'Outre-Mer. Aujourd'hui, la Polynésie s'engage vers un Pays d'Outre-Mer avec une autonomie plus large.